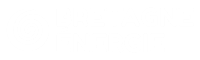Pour répondre à l’engagement de la France envers la Commission Européenne, la loi NOME a instauré l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH). Ce mécanisme, intégré dans le code de l’énergie, est essentiel pour réguler les prix de l’électricité en France, ce qui influence les factures des consommateurs. Vu la fin prévue de l’ARENH en 2025, il convient d’explorer son fonctionnement et les conséquences de sa suppression sur le marché de l’électricité et les habitudes des ménages.
Contexte et origine de l’ARENH
L’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) a été actif par la loi NOME du 7 décembre 2010 dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité en France. L’ARENH permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder à une partie de l’électricité nucléaire à un tarif régulé, conforme aux coûts de production.
L’ARENH est donc né d’un besoin de diversifier les sources d’énergie et de renforcer la compétitivité du marché électrique en France. Après les chocs pétroliers des années 1970, la France a investi massivement dans le nucléaire pour garantir son indépendance énergétique, aboutissant à un parc de 56 réacteurs fournissant environ 62 % de l’électricité en 2022. Avec l’ouverture du marché à la concurrence en 1999, EDF a vu sa position dominante remise en question. Ainsi, pour s’assurer que cette libéralisation n’entraîne pas une hausse des prix pour les consommateurs, l’ARENH a été mis en place. Ce dispositif garantit un accès équitable à l’électricité nucléaire, avec des tarifs fixés par les autorités. La concurrence saine est donc encouragée pour protéger les ménages des fluctuations du marché.
Fonctionnement de l’ARENH
L’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) permet aux fournisseurs d’électricité alternatifs d’acheter de l’électricité nucléaire produite par EDF à un tarif régulé, dans le but de favoriser la concurrence sur le marché. Le volume total d’électricité disponible par le biais de l’ARENH est limité à 100 TWh par an, ce qui équivaut à environ 25 % de la production nucléaire d’EDF. Le tarif est fixé à 42 €/MWh, un montant inférieur aux prix du marché de gros, afin de stabiliser les coûts pour les fournisseurs. Les droits d’accès sont attribués en fonction de la consommation de la clientèle des fournisseurs, permettant une distribution équitable. En cas de forte demande ou lorsque le plafond est atteint, les fournisseurs doivent se tourner vers le marché de gros.
À savoir
Notez que les fournisseurs doivent signer un accord-cadre avec EDF, puis soumettre une demande à la CRE au moins 40 jours avant chaque phase de livraison. De plus, la fin de l’ARENH pourrait augmenter les factures d’électricité de 15 % pour les consommateurs. Il est donc important de trouver une autre solution.
Les avantages de l’ARENH
L’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique présente plusieurs avantages pour les consommateurs et le marché de l’électricité en France :
- La stabilité des prix ;
- Une concurrence équitable ;
- La diminution des dépenses des consommateurs ;
- L’accès à une énergie propre ;
- La prévisibilité des coûts d’approvisionnement pour les distributeurs ;
- La protection contre les crises énergétiques.
Les limites et critiques de l’ARENH
L’ARENH présente certaines limites et fait l’objet de critiques :
- Plafonnement des volumes : Les fournisseurs sont limités à 100 TWh par an, ce qui peut restreindre l’accès à l’électricité pour les fournisseurs alternatifs, surtout en période de forte demande. Cela peut entraîner des tensions sur le marché et l’augmentation des prix pour les consommateurs.
- Prix jugé trop bas pour EDF : Le tarif de 42 €/MWh est considéré insuffisant pour couvrir les coûts de production et d’entretien du parc nucléaire d’EDF. EDF a exprimé des préoccupations quant à la viabilité financière du dispositif, car ce tarif ne garantit pas une rentabilité suffisante pour maintenir et renouveler ses installations.
- Asymétrie du dispositif : L’ARENH est critiqué pour son asymétrie. En période de prix de marché bas, EDF est contraint de vendre une partie de sa production à des tarifs inférieurs à ceux du marché, tandis qu’en période de prix élevés, il doit vendre à un prix régulé. Cela désavantage EDF et complique sa gestion financière.
- Suspension des contrats : Certains fournisseurs ont suspendu leurs contrats d’achat d’électricité via l’ARENH, réduisant ainsi les livraisons disponibles pour les autres fournisseurs. Ces suspensions peuvent conduire à des incertitudes sur l’approvisionnement en électricité et affecter la fiabilité pour les consommateurs.
- Manque de flexibilité : Le système ne s’adapte pas toujours bien aux fluctuations du marché. Par exemple, lorsque les prix de gros sont inférieurs au tarif ARENH, les fournisseurs sont moins incités à utiliser ce mécanisme, ce qui limite son efficacité dans un marché en évolution rapide.
- Effets d’aubaine et opportunisme : Certains fournisseurs sont accusés de revendre les volumes d’ARENH sur le marché à des prix plus élevés pour maximiser leurs profits. Ces pratiques peuvent créer des déséquilibres et soulever des inquiétudes sur l’équité et la transparence du marché.
- Incertitude sur l’avenir : Avec la fin prévue de l’ARENH en 2025, des incertitudes persistent sur son remplacement ou l’évolution du mécanisme. Cela crée une instabilité pour les fournisseurs et les consommateurs, qui doivent se préparer à des changements potentiels dans le paysage tarifaire de l’électricité.
L’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) a aidé à stabiliser les prix de l’électricité et à promouvoir la concurrence en France. Cependant, il présente des limites qui doivent être revues pour mieux aborder la fin de ce système.